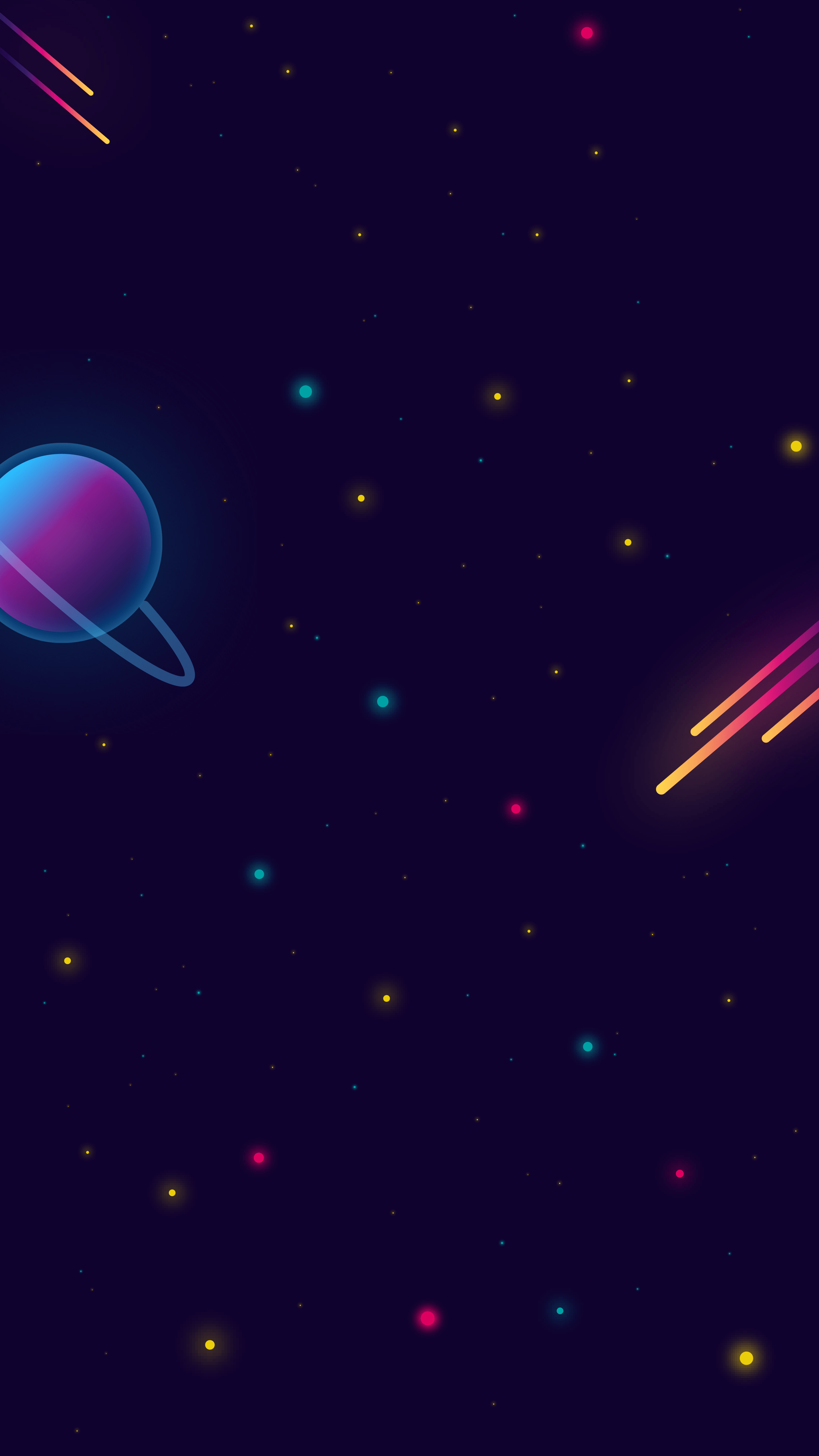Une question récurrente
Dans l’histoire des idées, on peut distinguer (en simplifiant un peu) deux attitudes diamétralement opposées au sujet de la raison d’être de l’humanité et de sa place dans l’univers.
D’un côté, la tradition hébraïque place très clairement l’être humain au pinacle de la création. Ce statut privilégié est évident dans le premier chapitre de la Genèse, où l’homme est créé en dernier et à l’image de Dieu. Il est également souligné dans un texte très explicite du Psaume 8 : « Qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? … Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, Et tu l’as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds, … ». Il s’agit d’un Psaume du roi David, qui est donc ancien d’environ trois mille ans.
De l’autre côté, une tradition que l’on pourrait appeler matérialiste ou rationaliste envisage l’humanité comme le résultat du hasard, comme une sorte de sous-produit de mécanismes aveugles et impersonnels propres à un univers dont l’existence elle-même ne revêt aucun sens particulier. Cette idée n’a rien de moderne : elle remonte aux atomistes grecs, en particulier Leucippe (460-370 av. J.-C.), et au Romain Lucrèce (94-54 ? av. J.-C.), qui plus tard popularisa la doctrine des atomistes dans son œuvre fameuse De rerum natura (« De la nature des choses »). Ce dernier auteur donne des arguments très intéressants en faveur de l’idée que toute matière est faite de particules extrêmement petites (les atomes), une intuition remarquable pour l’époque. Mais il expose aussi une vision philosophique qui est loin d’être neutre : « Car ce n’est certes point par réflexion, ni sous l’empire d’une pensée intelligente, que les atomes ont su occuper leur place ; ils n’ont pas concerté entre eux leurs mouvements. Mais… il est arrivé qu’après avoir erré durant des siècles, tenté unions et mouvements à l’infini, ils ont abouti enfin aux soudaines formations massives d’où tirèrent leur origine ces grands aspects de la vie : la terre, la mer, le ciel, les espèces animales. » (De la nature, traduction de J. Kany-Turpin, GF-Flammarion, 1964, pp. 167-168). Il écrit aussi : « … j’oserais encore … affirmer que la nature n’a pas été faite pour nous et qu’elle n’est pas l’œuvre des dieux : tant l’ouvrage laisse à désirer ! » (ibidem, p. 162).
Le clivage est manifeste : une vision du monde considère l’homme comme le prince et le gérant d’une création divine, résultat de l’amour attentionné d’un Dieu personnel ; au contraire, l’autre vision du monde assimile l’homme à un accident insignifiant issu de forces anonymes, une sorte de moisissure qui recouvre le grain de poussière qu’est notre Terre parmi les astres innombrables.
L’homme comme poussière d’étoiles
Depuis la fin des années 1920, nous savons que l’univers est en expansion, et qu’il a donc subi de profondes transformations dans le passé. Même si le scénario du Big Bang n’a été définitivement adopté que vers le milieu des années 1960 (voir l’article précédent), les cosmologistes avaient compris dès les années 1940-50 que l’hydrogène et l’hélium, les deux éléments les plus abondants de l’univers, avaient été créés dans les toutes premières minutes de la vie de l’univers. Les astrophysiciens (ceux qui étudient la physique des étoiles), quant à eux, avaient compris avant la fin des années 1950 que les autres éléments (carbone, oxygène, azote, silicium, fer etc.) ont été synthétisés dans le cœur des étoiles puis dispersés dans l’espace à la mort de celles-ci.
Si nous existons, c’est grâce à des processus qui eurent lieu dans les trois premières minutes de l’univers (production d’hydrogène) puis des centaines de millions d’années plus tard au cœur des premières étoiles – et de leurs descendantes. Supprimez les trois premières minutes, et vous n’aurez pas d’hydrogène, donc pas d’eau ni aucune molécule organique ; supprimez la synthèse des noyaux atomiques plus lourds dans les étoiles ou leur dispersion dans l’espace (via les explosions de supernovae ou les vents stellaires), et vous n’avez ni carbone, ni oxygène, ni phosphore, etc., donc pas non plus d’eau ni de molécules organiques. C’est la raison pour laquelle l’astrophysicien Hubert Reeves a pu dire que nous sommes « poussière d’étoiles » dans son best-seller judicieusement intitulé « Patience dans l’azur » (Seuil, 1980).
L’évidente existence d’un réglage fin (« fine tuning »)
Depuis que l’on sait que l’univers a évolué, qu’il a une histoire, on a pris conscience du fait que les propriétés à grande échelle de l’univers ne sont pas déconnectées des propriétés de la nature à petite échelle, même celle des particules élémentaires. De plus, on peut « construire » des modèles d’univers sur ordinateur, grâce à la théorie de la relativité générale d’Einstein, et on peut voir comment se comporte le modèle selon les valeurs d’un petit nombre de paramètres : densité moyenne actuelle, vitesse actuelle d’expansion, etc. Ainsi, on se rend compte que pour abriter la vie, c’est-à-dire nous, l’humanité, l’univers doit avoir des paramètres appropriés. Par exemple, si l’univers s’expand trop vite, les nuages de gaz s’effilochent avant de pouvoir se condenser sous l’effet de leur propre gravité et former des étoiles. S’il s’expand trop lentement, il va former beaucoup d’étoiles mais son expansion va s’arrêter et il va s’effondrer sur lui-même avant que la vie ait eu le temps d’évoluer sur une planète, à supposer que les planètes elles-mêmes aient pu se former.
Mais ce n’est pas tout : en physique, il existe des « constantes » comme la vitesse de la lumière c, la constante de gravitation G ou encore la constante de Planck h. Par exemple, la théorie de Newton de la gravitation dit que la force qui s’exerce entre deux masses m1 et m2 a une intensité F= G m1 m2/r2, où r est la distance entre les masses. On peut mesurer G, mais aucune théorie (même la relativité générale, qui a supplanté la théorie de Newton) ne nous dit quelle valeur elle doit avoir. Par conséquent, on peut imaginer un univers où la constante G aurait une valeur différente de celle qu’elle a dans le nôtre. Mais serait-il capable d’abriter la vie ? On peut poser la même question au sujet d’autres constantes comme la charge de l’électron, les masses des particules élémentaires, etc. Des livres entiers ont été écrits pour traiter cette question, et il apparaît que fabriquer un univers fécond (dans le sens de « capable d’abriter la vie ») n’est pas si simple. : il faut ajuster finement les constantes de la physique pour cela ! Certains sont allés jusqu’à poser la question de la forme même des lois physiques : par exemple, qu’arriverait-il si la force de gravité ne décroissait pas en 1/r2, mais en 1/r3 par exemple ? Eh bien, les orbites ne seraient pas stables !
Quelle conséquence quant au statut de l’homme ?
Nous savons depuis Copernic que l’homme n’est pas situé au centre géographique de l’univers et que, d’ailleurs, il est impossible de définir un centre à l’univers. Par contre, on se rend compte que tout est lié, depuis les échelles microscopiques jusqu’aux amas de galaxies et à l’univers tout entier, et que notre existence tient à un ajustement qui ne peut que nous émerveiller. Pour justifier son idée de l’insignifiance de l’homme, Jean Rostand écrivit par exemple : « Sa réussite a de quoi lui tourner un peu la tête. Mais, pour se dégriser aussitôt, qu’il situe son royaume dérisoire parmi les astres sans nombre que lui révèlent ses télescopes : comment se prendrait-il encore au sérieux, sous quelque aspect qu’il s’envisage, une fois qu’il a jeté le regard dans les gouffres glacés où se hâtent les nébuleuses spirales ! » (Pensées d’un biologiste, Stock, 1954, 1978, p. 103). Ce que nous montre en réalité la cosmologie moderne, c’est qu’il n’y a pas vraiment de solution de continuité entre notre « royaume dérisoire » et les « gouffres glacés » dont parle Rostand : tout est lié par les lois de la physique et l’architecture cosmique, si bien que l’un ne va pas sans l’autre. Le « réglage fin » mis en évidence plus haut mène à la notion de « principe anthropique » (du grec « anthropos », l’homme) selon lequel l’homme jouit d’une sorte de privilège, ou de conspiration cosmique, pour ainsi dire, qui a permis son existence et son épanouissement dans un environnement favorable. Cela ne relève-t-il pas bien plus d’un statut de prince que de celui d’une moisissure ? Si un athée comme Jean Rostand pouvait déjà définir l’homme comme un miracle – même sans intérêt – à une époque où personne n’avait conscience de ce « réglage fin », ne devrions-nous pas désormais considérer l’homme comme un miracle extrêmement intéressant, et nous interroger sur l’Auteur de ce miracle ?